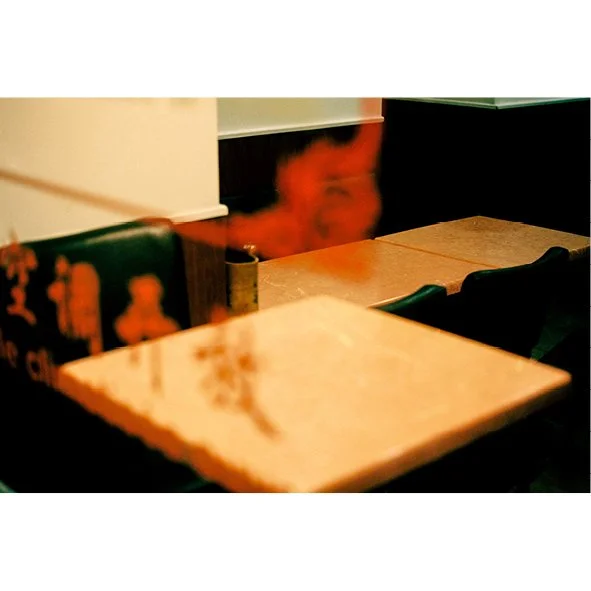Yàala
En bambara, l’un des dialectes les plus parlés au Mali, “Yàala” signifie une promenade. Celle que l’on fait en fin de journée, quand la chaleur retombe et la ville s’adoucit. À Bamako, souvent la poussière se lève tandis que s’affairent, la nuit venue, les commerçants n’ayant pas encore fini d’écouler leurs marchandises. Plus loin, au bord du Niger, les Bozos travaillent la terre et pêchent dans ce fleuve que leurs familles habitent depuis des siècles. Tandis que les enfants reviennent de l’école depuis les îles qui essaiment le fleuve, les trois grands ponts de la ville vrombissent des défilés de « djakarta », de « sotramas » et de « catacatani ». En dehors de la capitale, la frénésie n’est plus qu’une lointaine rumeur, la nature reprend ses droits.
LLa guerre au Mali s’est étendu sur plus de dix ans (2012-2023). Si la présence de groupes armés s’est principalement concentrée dans le nord du pays, l’intégralité du territoire est touchée par la montée du terrorisme. En 2012, les premières villes à être tombées sont Gao et Kidal dans le Nord, puis Mopti et Ségou en 2013, précipitant l’entrée en guerre de l’armée française. Des mouvements de populations du Nord vers le Sud et notamment vers la capitale, Bamako, s’en sont suivis et ont profondément changé les dynamiques du pays. Parallèlement, il est devenu très difficile pour des ressortissants étrangers de se déplacer librement au Mali, contraignant leurs déplacements à Bamako et sa région. Ce fût mon cas lorsque j’habitais à Bamako. De ce contexte est née la série « Yàala », réalisée entre 2021 et 2022, avec la volonté de montrer la vie dans la capitale malienne et ses environs tandis que le reste du pays basculait progressivement dans une période de grandes incertitudes.